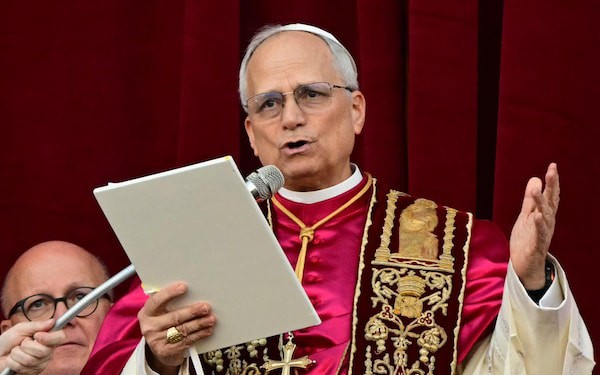Les travaux de la première session 2021 du Conseil d’orientation du Programme d’urgence pour le Sahel ont été officiellement lancés le vendredi 12 mars 2021 à Ouagadougou par le Premier ministre Christophe Dabiré. Il s’agit pour cette session, de faire une rétrospective de la session passée et envisager de meilleures perspectives pour les mois à venir.
Par Etienne Doly, stagiaire
Le Conseil d’orientation stratégique (COS) du Programme d’urgence pour le Sahel (PUS-B) dresse un bilan positif des activités de l’année 2020. Pour la ministre déléguée en charge de l’Aménagement du territoire, Pauline Zouré, le bilan de l’année 2020 est satisfaisant car l’insécurité connait de plus en plus une décroissance. « Compte tenu de l’adversité qui a commencé à décroître dans les zones concernées, nous nous sommes rendus compte que cette année les actions ont connu un bond qualitatif en termes d’exécution », a-t-elle indiqué.
Le taux d’exécution de 2020 a ainsi connu une hausse comparativement à celui de l’année précédente. Il se chiffre à 66,7% contrairement à l’année 2019 où ce taux était à 64%. Le taux d’exécution financière de 2020 est de 45,34 %. Pour la ministre, cela constitue « une bonne performance au regard du quota d’activités en cours de réalisation qui n’ont pas été prises en compte dans ce taux ».
Le premier ministre, Christophe Dabiré, a exhorté le Conseil d’orientation à travailler davantage pour « la restauration d’un climat de paix, de confiance et de cohésion sociale » et à veiller au bon fonctionnement du Programme. Pour le Premier ministre, la mise en œuvre du Programme d’urgence pour le Sahel a permis d’améliorer « les conditions de vie des populations »

Le programme a été mis en place depuis 4 ans et couvre les régions du Sahel, du Nord, de la Boucle du Mouhoun, du Centre Nord, de l’Est et le Centre-Est. La mise en œuvre du PUS s’est articulée autour de quatre principaux axes. Il s’agit d’abord de la prise en charge des défis sécuritaires avec la réhabilitation des commissariats de police, des brigades de gendarmerie dans les régions concernées par le Programme. L’exécution du programme a également permis l’équipement en matériels et mobiliers, au profit des agents de sécurité.
Le deuxième volet du programme est l’optimisation des urgences humanitaires et sociales. Concernant cet axe, 1000 personnes déplacées internes ont bénéficié d’une assistance alimentaire, d’un appui psychologique, de l’établissement d’actes de naissance et de la mise en place de cadres d’éveil pour les enfants.
Les acquis engrangés au niveau de l’axe 3, sont relatifs au renforcement de la présence de l’État. Le programme a permis de fournir des matériels informatiques et de communications à 17 services de sécurité et à des centres d’état civil de 15 communes. Ce qui a permis la délivrance de plus de « 18 000 Cartes nationales d’identité (CNIB) et d’autres documents d’état civil aux citoyens », a expliqué le chef du gouvernement. Les actions entreprises au niveau de l’axe 4 du programme ont consisté à la construction des bases de la résilience des populations et des territoires. Ceci à travers des équipements marchands qui ont été réalisés au profit des collectivités territoriales.
Le Conseil d’orientation stratégique (COS) du Programme d’urgence pour le Sahel a formulé des recommandations à l’endroit du gouvernement pour améliorer la réalisation des activités à venir. Il s’agit d’abord de l’allègement des procédures en ce qui concerne les actions à mettre œuvre. Il est donc nécessaire de « revisiter l’ensemble de la gouvernance et des textes », a laissé entendre la ministre déléguée.

Cela vise à donner plus de pouvoir aux collectivités territoriales, aux gouverneurs et aux autres acteurs décentralisés pour permettre une plus grande fluidité et la célérité des actions, a expliqué Pauline Zouré. Le Conseil d’orientation compte s’inscrire dans une dynamique de continuité de sécurisation du territoire. À en croire la ministre déléguée de l’aménagement du territoire, les actions de sécurisation vont continuer en crescendo à travers un plan spécifique de stabilisation qui sera mis œuvre dans deux communes pilotes que sont Djibo et Pobé Mengao. L’ensemble des acteurs concernés seront mis à contribution pour une mise en œuvre réussie de ce plan de résilience et de stabilisation.