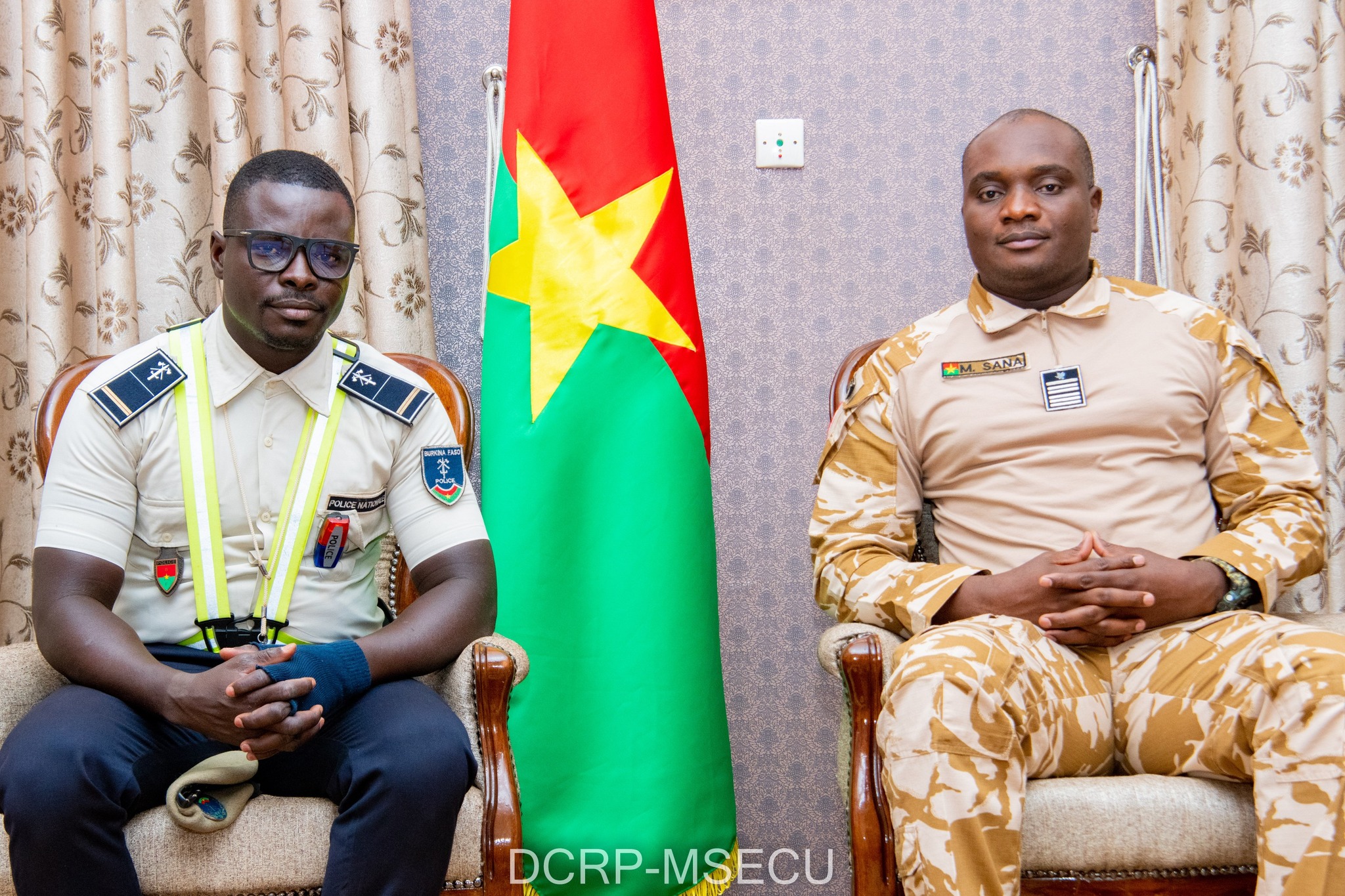Le 16 novembre 2024, Docteur Choguel Kokalla Maiga (CKM) est sorti de sa réserve que lui imposait la nomenclature institutionnelle de son poste de premier ministre de son pays, pour faire des déclarations qui ont surpris plus d’un.
En substance, tout en s’abstenant de critiquer vertement les autorités militaires de la Transition malienne, il ne s’est pas gêné d’exprimer son mécontentement à propos de la conduite du processus de ladite transition.
Ainsi, il a reproché aux autorités militaires de son pays le manque de transparence sur deux points essentiels : la date de la fin de la transition et l’organisation des élections qui devraient en découler.
Devant un auditoire enthousiasmé, s’exprimant tantôt dans la langue de Molière tantôt dans une langue du terroir , c’est-à-dire le Bambara, CKM, bien à son aise devant ses partisans, a égrené un chapelet de critiques. Quelques jours plus tard, c’est-à-dire le 20 novembre 2024, sans grande surprise, il se voit remercier de son poste de premier ministre. Quelles leçons peut-on alors tirer de ce nouveau développement politique au Mali ? A notre humble avis, et en s’appuyant sur la grille de lecture de l’école de l’Analyse stratégique de Michel Crozier et d’Erhard Friedberg, trois grandes idées s’en dégagent essentiellement.
D’abord, il faut noter que CKM est un homme politique de type joueur (Guerandi, 2003) qui a peu peur de bousculer les normes juridiques et les pratiques politiques de son pays. En effet, en vertu du principe de la responsabilité collégiale, qui est l’un des principes directeurs de toute action gouvernementale, quand on n’est pas d’accord avec la ligne directrice de son chef, on démissionne et on se tait. En français facile, ce principe signifie seulement que le linge sale se lave en famille. Mais, CKM n’a fait ni l’un ni l’autre.
Non seulement il n’a pas démissionné, mais plus il a organisé un meeting politique au cours duquel il a étalé ses critiques sur la Transition malienne sur la place publique. C’est un vrai coup de surprise de la part de celui qui, jusqu’à son limogeage, était considéré comme l’un des éléments clés de la Transition malienne. Sciait-il consciemment la branche sur laquelle il était assis ? Non, pas du tout !
En demandant publiquement aux autorités militaires de clarifier leur position sur la suite du processus de la Transition malienne, CKM a bien voulu rebattre les cartes politiques et prendre le contrôle de sa destinée politique, jusque-là dans les mains des soldats de Kati.
Une telle attitude empreinte de risques politiques, est digne des acteurs politiques de type joueur comme Kwamé N’Krumah, Sékou Touré, Patrice Lumumba, Jerry Rawlings, Thomas Sankara, etc. côté africain ; côté non africain on peut citer Mao en Chine, Napoléon, de Gaulle en France, Winston Churchill en Grande Bretagne, Gandhi en Inde, etc. Ce type d’acteurs politiques n’a pas peur de prendre des risques, le système socio-politique dans lequel ils évoluent, ne pouvant pas les enfermer.
En effet, quelle que soit la lourdeur des contraintes du système socio-politique, l’acteur conserve toujours une marge de liberté qu’il peut utiliser pour atteindre ses objectifs (Crozier, 1977). Et l’acteur politique de type joueur le sait instinctivement.
Ensuite, la sortie de CKM nous révèle comment les éléments de la Transition malienne interagissent entre eux. Dans le langage de l’école de l’Analyse stratégique on parlera de dynamique au sein du groupe, qui est un élément très important pour comprendre la structuration des rapports de pouvoir entre les membres du groupe (Crozier, 1977 ; Friedberg, 1991).
Pour Crozier et Friedberg, pour bien comprendre la dynamique au sein d’une organisation, quelle qu’elle soit, il faut aller au-delà des aspects formels et institutionnels pour appréhender comment chaque acteur utilise à son propre escient la marge de manœuvre dont il dispose dans l’organisation pour faire face aux zones d’incertitude qui surgissent dans ses rapports avec les autres (Friedberg, 1991).
Quoiqu’on puisse dire sur le nouveau développement politique au Mali, il est clair que la dynamique du pouvoir est aux mains des autorités militaires qui impriment le rythme de ladite Transition.
Cependant, il est fort vraisemblable que cette dynamique n’a pas encore généré un mécanisme intérieur régulateur capable de résorber les crises, qui ne manquent de surgir entre ses membres. Sinon, pourquoi le linge sale de la politique malienne sous la Transition a été lavé en public ?
Enfin, on pourrait alors logiquement se demander quelles seront les implications de cet événement pour la suite de la Transition au Sahel. Les conséquences de ce nouveau développement politique au Mali pourraient être au nombre de deux, mais pas seulement.
D’abord, du côté de la CEDEAO l’espoir de revoir les membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) revenir au bercail renait. On pourrait même ajouter que chez ceux qui tiennent la ligne dure au sein de la CEDEAO, sans oublier l’Elysée l’ancienne puissance coloniale vouée aux gémonies pour avoir abandonné les Etats du Sahel en plein vol (ce sont les termes de CKM à la tribune des Nations Unies), c’est la jubilation.
Pour ceux-ci, le meilleur scenario c’est l’exacerbation des dissensions au sein de leurs adversaires AES de même manière à les affaiblir jusqu’à la désagrégation de leur nouvelle confédération et les pousser à rejoindre la CEDEAO avant la date butoir. Telle est l’essence de leur Realpolitik.
Deuxièmement, ce limogeage de CKM confirme le fait qu’il est difficile de sécuriser la démocratie électorale sous nos tropiques.
La sécuritisation est un concept forgé par l’Ecole de Copenhague des études de sécurité, pour signifier qu’en cas de menace existentielle contre la vie de la nation, les autorités du pays peuvent se donner le droit de mettre en parenthèses les droits et libertés des citoyens le temps de résoudre la crise. L’un des aspects fondamentaux des trois Etats de l’AES, découlant de la lutte contre le terrorisme, est la sécuritisation de la question électorale.
Pour se donner les coudées franches devant leur permettre de combattre l’hydre terroriste qui endeuille les paisibles populations du Sahel et menace l’existence même des Etats de cette zone, les autorités des trois Transitions ont sécurisé l’organisation des élections, en témoignent les discours de déclaration de politique générale du Premier ministre burkinabè devant l’Assemblée législative de transition (ALT). La sortie de CKM vient nous rappeler que cette sécuritisation est difficilement acceptée par certains acteurs politiques.
CKM est parti, mais la Transition malienne est toujours là. Cependant, avec un tel événement bon nombre d’observateurs de la scène politique malienne sont partagés entre l’espoir d’une Transition triomphatrice et le doute d’un retour aux bons vieux temps de luttes byzantines politiciennes ponctuées de manifestations et de contre manifestations (Gazibo, 2010), cette fois-ci entre les militaires d’un côté et les politiciens aguerris comme CKM, l’Iman Dicko, etc. de l’autre.
Vivement qu’un tel scénario de lutte politique s’éloigne des rives du fleuve Djoliba pour que les panafricanistes puissent continuer de rêver…
Dr. Jean-Baptiste GUIATIN
Politiste internationaliste, Enseignant-chercheur à l’Université Joseph Ki-Zerbo
Fulbright 2016.
Conseiller des affaires