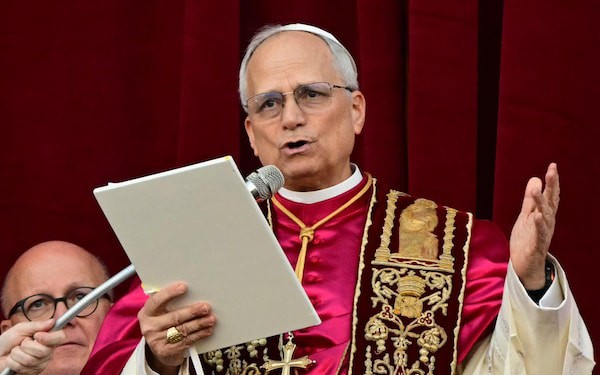Le doctorant Adama Mandjin Soulama a soutenu sa thèse le 30 décembre 2024 à l’Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou. Originaire de la région des Cascades au Burkina Faso, son sujet a porté sur « Etude comparative des ceraamba et curaba du village de Kossara à travers les chansons de mariage », deux communautés de la même région. C’est avec brio qu’il a défendu son étude devant un jury d’éminents enseignants des universités du Burkina, de la Côte d’Ivoire et du Mali. Convaincu de la qualité de son étude, le jury lui a attribué la mention « Très honorable ».
Par Hakim Hien
Les communautés ceraamba et curaba ont longtemps vécu ensemble depuis des siècles dans leur milieu (Région des Cascades). Dès lors, elles sont confondues l’une à l’autre comme une seule société par plusieurs personnes étrangères à celles-ci. C’est ainsi que le doctorant Adama Mandjin Soulama a fait dans le cadre de sa thèse une étude comparative pour « clarifier les opinions ».
De prime à bord, les fruits de ce travail de recherche indiquent que les noms « Ceraamba » et les « Curaba » viennent d’une affabulation des termes de l’appellation ethnique de ces deux communautés. En effet, le nom Gouin qui est couramment utilisé pour désigner les Ceraamba vient du bandji. Car les Ceraamba appellent le bandji : kwinw. Etant de grands consommateurs de kwinw, c’est-à-dire le bandji, ils sont ainsi appelés par ce nom du colon.
Ce nom sera écrit par les ethnologues de plusieurs manières d’où l’origine du nom ethnique ‘‘Gouin’’ pour désigner les Ceraamba. Quant aux Curaba, le nom Turka, viendrait de leur premier village qui est Tourny. C’est dans ce sens que l’appellation Turka tire son sens du terme ‘‘Tourny-kanw’’. Ce terme ‘‘Tourny-kanw’’ vient de la langue jula et voudrait dire les habitants de Tourny, les ressortissants de Tourny. Car eux-mêmes s’appellent ‘‘curaba’’, révèle le doctorant Adama Mandjin Soulama
Monsieur Soulama explique qu’il existe certes des similitudes entre les Ceraamba et les Curaba mais ces similarités ne peuvent pas faire de ces communautés, une et même communauté. « Les Ceraamba ont leurs villages, leurs terres, leurs chefs de terre, et leurs coutumes ; les Curaba aussi. », dit-il
Ainsi, dans le cadre de cette étude, l’un des facteurs de rapprochement des Ceraamba aux Curaba est le mariage. Les relations matrimoniales sont des actes forts de la vie de ces communautés depuis des années. « Certes, dans le mariage des Ceraamba et des Curaba, il existe autant de ressemblances que de dissemblances, gage de familiarité, de solidarité et de paix entre eux. », soutient le doctorant
En outre, il explique que « les ressemblances sont dues au fait que les deux communautés ont une même origine (le Ghana actuel) et d’une longue coexistence pacifique et séculaire entre les premiers ancêtres ceraamba et curaba. En plus, les interférences culturelles et linguistiques sont des preuves vivantes de l’inter-culturalité entre elles, de l’unicité entre ces communautés. »

Selon Adama Mandjin Soulama, cette étude comparative du mariage démontre que les Ceraamba et les Curaba sont des communautés différentes en témoignent les disparités constatées. En effet, de vertu d’une idéologie romantique qui place l’amour au-dessus des lois et des contraintes sociales, le mariage d’amour et sa célébration sont généralement présentés par les futurs époux comme des actes individuels, qui pourraient désormais échapper à la « tradition ».
Sous ce terme, les jeunes s’opposent en réalité à deux types de contraintes : le caractère attendu et répétitif du rituel d’une part, et son caractère standardisé d’autre part. Pour créer un mariage « qui leur corresponde », les futurs époux doivent donc lutter sur deux fronts pour éviter à la fois le conformisme historique et le conformisme social d’un mariage classique ou traditionnel. Cette quête d’une double distinction permet d’expliciter les transformations récentes du mariage.
Le jour J du mariage se voit être le fruit d’une très longue période d’élaboration qui, depuis une vingtaine d’années, ne cesse de s’allonger (un an en moyenne) et de se complexifier. Avant même d’engager les « préparatifs » de leur mariage (c’est‑à-dire de leurs noces et non pas de leur engagement conjugal), les futurs époux se prêtent de plus en plus systématiquement à une série « d’annonces » de leur mariage dans différents cercles relationnels : leur couple, leurs amis, leur famille et ses éventuelles recompositions qui marquent cette génération.
En vertu d’une idéologie romantique qui place l’amour au-dessus des lois et des contraintes sociales, le mariage d’amour et sa célébration sont généralement présentés par les futurs époux comme des actes individuels, qui pourraient désormais échapper à la « tradition ».
Sous ce terme, certains jeunes voient contraignant : le caractère attendu et répétitif du rituel du mariage coutumier d’une part, et son caractère standardisé d’autre part. Pour créer un mariage ‘’ qui leur corresponde ‘’, les futurs époux doivent donc lutter sur deux fronts pour éviter à la fois le conformisme historique et le conformisme social d’un mariage classique ou traditionnel. Cette quête d’une double distinction permet d’expliciter les transformations récentes du mariage.

La recherche des alliances, les types de dot (dot physique ou agricole, la dot alimentaire, la dot d’entretien de la femme), l’effectivité du symbolisme de l’excision, l’importance de la femme dans le système matrilinéaire (l’enfant appartient à la mère), la gestion de la famille, les droits et devoirs dans le foyer, les interdits, le caractère ontologique du mariage, la procréation entre autres sont presque identiques aux Ceraamba qu’aux Curaba.
Par contre, dans ces communautés, certains types de dot (la dot financière, la dot matérielle), les rites de mariage, les cérémonies de mariage, les cérémonies de l’après mariage, les chansons de mariage, le son des instruments de musique, la manière de danser ne sont pas les mêmes entre autres. Ils sont spécifiques à chaque communauté. C’est ainsi que chaque société à sa particularité et se distingue l’une de l’autre par des différences.
De l’analyse du corps, il ressort que le mariage renferme plusieurs fonctions : la fonction sociale, culturelle, éducative, éthique, esthétique, ludique, religieuse, spirituelle, de séduction et de procréation entre autres. Ce sont des notions qui participent à l’éducation sociale de la communauté et restent codifiées dans les chansons.
En plus, d’être une école, d’avoir ce pouvoir de transmission des valeurs ancestrales aux communautés ceraamba et curaba, le mariage continue d’unir les hommes, les familles, les sociétés. C’est un moyen puissant de regroupement, de solidarité, de rapprochement des familles et des communautés différentes.
Au terme de sa recherche, le doctorant a souligné que le mariage ceraamba et curaba présentent des ressemblances au regard de l’origine des deux communautés. Cependant, des particularités peuvent être observées et se justifient par le rapprochement des Ceraamba aux Karaboro et des Curaba aux Toussian.

De ce fait, il indique qu’« on peut affirmer que nos hypothèses sont vérifiées ». En fin de compte, dans les deux communautés, le mariage renferme plusieurs fonctions : la fonction culturelle, éducative, éthique, esthétique, ludique, religieuse et spirituelle entre autres. Le mariage demeure cette institution de regroupement, de solidarité, de rapprochement des familles et des communautés différentes.
Telles les communautés ceraamba et curaba, beaucoup de communautés au Burkina Faso partagent des valeurs culturelles depuis des siècles à travers l’institution du mariage. Aucune société ne vit dans l’autarcie ou ne vit isolée des autres. Toutes les sociétés s’interpénètrent et s’interagissent.
C’est pourquoi nous devons, nous accepter dans la différence afin d’éviter les conflits intercommunautaires. Une telle étude de recherche a besoin d’être encouragée car elle sonne comme une piste de solution aux problèmes sécuritaires que traverse le Burkina Faso.