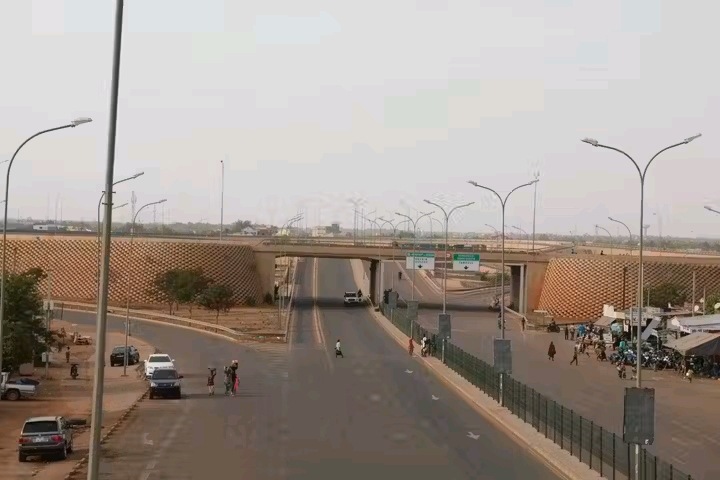Dans une tribune parvenue à Libreinfo.net, son auteur Jean-Baptiste Guiatin, Docteur en Science Politique (Université Thomas Sankara) analyse les Relations France Sahel à partir des turbulences socio-politiques que connaissent certains pays comme le mali et le Burkina Faso et trouve que ce Partenariat devient impossible autant que la Rupture est improbable. Après la publication de la première partie de cette tribune, nous vous proposons la deuxième et dernière partie.
Partie II : Retour au Futur d’une Rupture Improbable
Dans les faits, le terrorisme est en train de changer la donne au Sahel, en tout cas pour ce qui concerne les relations entre la France et ses anciennes colonies. En effet, l’insurrection djihadiste que connaît la bande sahélo-sahélienne depuis 2012, est en train de reconfigurer le système franco-africain tel que voulu par le Général de Gaulle dans les années 1960.
La perspective de cette reconfiguration est tellement profonde que certains parlent même de rupture. Cependant, celle-ci est loin d’être probable au moins dans l’immédiat et le court terme. Trois raisons pourraient justifier une telle position.
La première raison est reliée à l’histoire et au processus socio-historique ayant donné naissance à la Françafrique, et relève donc de l’approche constructiviste. Quand Louis de Guiringaud disait que l’Afrique noire demeure le seul endroit au monde où la France « peut changer le cours de l’histoire » (Bayart, 1990 : 47), il n’a probablement pas oublié d’expliquer à son auditoire les raisons d’une telle situation, qui tiennent plus à l’histoire entre la France et cette partie du monde qu’à toute autre chose.
En effet, à la suite de la conquête coloniale, et contrairement aux Britanniques qui ont préféré instaurer l’Indirect Rule dans leurs colonies africaines, les Français ont instauré une politique assimilationniste.
Celle-ci a essentiellement consisté à amener progressivement les peuples colonisés d’Afrique et d’ailleurs à adopter la culture française. Et le cas des quatre communes du Sénégal en est une illustration parfaite.
Du Sénégal, cette politique assimilationniste s’est étendue aux autres territoires africains conquis. La particularité de cette politique assimilationniste à la française est qu’elle a été, à la différence des autres possessions françaises en Asie, un vrai succès en Afrique noire (Chipman, 1989).
Et les constructivistes vous diront qu’un tel succès suffit à expliquer pourquoi les pays africains éprouvent de sérieuses difficultés à se détacher de l’ancienne puissance coloniale, qui demeure à maints endroits la seule référence.
Par exemple, les constitutions de presque tous les pays francophones d’Afrique noire sont, à bien des endroits, une copie mal digérée de la constitution française de 1958.
La deuxième raison concerne la forte interdépendance socio-économique au sein de la maison franco-africaine. Elle relève de l’approche libérale des relations internationales. En fait, sur le plan économique la plupart des pays francophones africains sont essentiellement tournés vers la France.
Outre des économies extraverties tournées vers l’ancienne métropole, celle-ci demeure l’un des gros bailleurs de fonds de ces pays pauvres très endettés. Enfin, la France est l’intermédiaire obligé de ces pays dans leurs rapports avec les institutions financières internationales, notamment la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International (Clapham, 1996).
Si un pays africain veut voir sa dette rééchelonnée, il doit passer par le Club de Paris. En plus, la France gère la banque centrale commune aux huit pays de l’Afrique de l’Ouest.
En contrepartie, le Soft Power français rayonne dans tous les secteurs de la vie socio-économique de ces pays africains : médias, commerce, mines, éducation, culture, recherche scientifique, etc. sans compter le fait que ces différents pays africains constituent une belle clientèle diplomatique pour la France dans l’arène des organisations internationales.
Enfin, la troisième raison relève de la perspective réaliste des relations internationales et insiste sur le fait qu’aucune partie ne veuille ou ne parle actuellement et de façon sérieuse de rupture.
Il est intéressant de remarquer qu’en dépit de la rhétorique officielle et la volonté de diversifier leurs partenaires pour la sécurisation de leurs territoires, les dirigeants politiques actuellement aux destinées des pays frondeurs – Burkina Faso et le Mali – ne semblent pas demander le divorce radical avec la puissance tutélaire française.
Ils semblent plutôt demander une sorte de reconfiguration, un rééquilibrage de rapports franco-africains pour tenir compte des exigences du moment, des aspirations des populations sahéliennes à vivre en sécurité et dans l’espérance d’un lendemain meilleur. De leur point de vue, l’enjeu porte sur la survie même de leurs Etats.
De l’autre côté, la France ne semble pas être prête à partir. Une fois chassée du Mali et du Burkina Faso, elle a déposé ses valises militaires au Niger sans compter le fait que ses bases militaires au Sénégal, au Tchad, et en Côte d’Ivoire restent fonctionnelles.
Une sorte d’exit policy n’est pas encore perceptible dans la rhétorique officielle française. On parle aussi de reconfiguration, de nouveau partenariat entre la France et les Etats africains. En témoigne la toute dernière intervention de la ministre française des affaires étrangères au Sénat français.
Dans un couple où on se dispute sans vouloir ou pouvoir divorcer, le film des scènes de ménage va donc continuer. Espérons donc un bon dénouement !
Lire la première partie: Tribune: relations France-Sahel : un partenariat impossible, une rupture improbable
Références
- Anderggen, A. 1994. France’s Relationship with Sub-Saharan Africa, London : Praeger.
- Battistella, D et al. 2012. Dictionnaire des Relations Internationales. Paris : Dalloz.
- Bayart, J-F. (1990). « La Fin du Pacte Colonial » in Politique Africaine, numéro 39.
- Chafer, T. 2002. « Franco-African Relations No Longer Exceptional ? » in African Affairs, vol. 101, number 404 : 343-363.
- Chipman, J. 1989. French Power in Africa. Oxford : Basil Blackwell ltd.
- Clapham, C. 1996. Africa in the International System : the Politics of Survival, Cambridge : Cambridge University Press.
- Gazibo, M. 2010. Introduction à la Politique Africaine. Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal.
- Martin, G. « Continuity and Change in Franco-African Relations » in The Journal of Modern African Studies33, number 1 : 1-20.
- Staniland, M. 1987. « Francophone Africa : the Enduring French Connection » in the Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 489 : 51-62.
Jean-Baptiste GUIATIN
Docteur en Science Politique (Université Thomas Sankara)
Fulbright 2016 Master of Arts in International Affairs, Washington D.C.
Conseiller des Affaires Etrangères
Lefaso.net, « La France veut bâtir une relation nouvelle, équilibrée et réciproque avec les pays africains, dixit la Ministre française des affaires étrangères », disponible sur le site internet www.lefaso.net, date d’accès : 11 juin 2023.