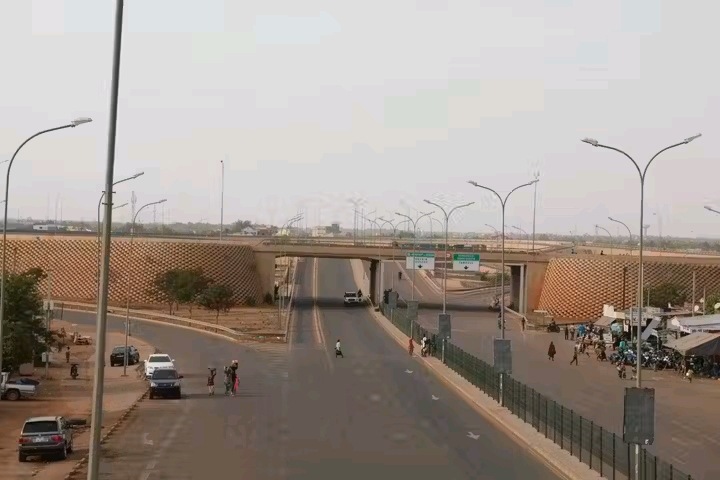Ceci est une tribune du Dr Jean-Baptiste Guiatin sur les relations entre la France et le Sahel
Chers Lecteurs, une autre manière de comprendre les raisons de la débâcle de la France au Sahel est de s’intéresser à sa politique africaine, c’est-à-dire sa politique étrangère envers les pays africains, notamment ceux d’Afrique noire au sud du Sahara, en particulier ceux qui sont francophones.
En général, quand on parle de la politique étrangère d’un pays on fait référence à l’attitude générale de ce pays envers les autres acteurs des relations internationales qu’ils soient des Etats, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales, ou des individus, etc.
Il est aussi possible d’avoir une idée de la politique étrangère d’un pays en examinant minutieusement ses prises de position sur les problèmes internationaux qui mobilisent l’attention des acteurs du système international. Par exemple, sur le problème entre l’Israël et la Palestine on pourra dire qu’un pays est pro-israélien ou pro-palestinien (pro-arabe).
Mais, il y a un autre référentiel qui peut indiquer la direction de la politique étrangère d’un Etat : c’est sa doctrine de politique étrangère. Aux Etats-Unis, les analystes vous parleront de la doctrine Monroe, de la doctrine Truman, de la doctrine Nixon, etc. L’Union Soviétique a eu ses doctrines Jdanov et Brejnev.
Une doctrine de politique étrangère est l’ensemble des grandes lignes devant guider l’attitude et les actes d’un pays envers les autres acteurs du système international. Cette doctrine peut être écrite ou non. Comparaison n’est pas raison, mais on peut dire que la doctrine est pour la politique étrangère ce que la constitution est censée être pour un pays en droit interne. Quid de la France ?
Partie I : La France a-t-elle une doctrine de politique étrangère ?
Bien sûr ! Comme toute puissance mondiale qui se respecte, la politique étrangère de la France s’est toujours efforcée de se donner une direction, une doctrine même s’il faut feuiller plusieurs documents ou écouter d’innombrables messages audios de personnalités clés de Quai d’Orsay et de la présidence française avant de se faire une idée de cette doctrine.
Pour faire court, disons que cette doctrine a varié en fonction des enjeux auxquels la France a dû faire face. C’est donc dire que la doctrine française de politique étrangère est tributaire du temps et des grandes questions du moment, mais surtout de la survie de la France en tant que puissance mondiale telle qu’elle se perçoit.
Par exemple, la politique étrangère de la France du 19ème siècle est très différente de celle du 20ème siècle parce qu’entre temps les défis auxquels la France a dû faire face ont changé, souvent drastiquement.
Après la défaite française en 1870 face à l’Allemagne de Bismarck, la doctrine de la France était orientée vers la garantie de son existence en tant qu’Etat, mais aussi vers la restauration de son prestige en tant que puissance européenne respectée.
C’est l’une des raisons de l’engagement de la France dans la compétition coloniale avec les autres puissances européennes (Espagne, Portugal, Allemagne, Angleterre, Italie). Parlant de ces aventures coloniales, si les pays comme l’Espagne, le Portugal, l’Allemagne, l’Angleterre, la France ont tiré leur épingle du jeu colonial en Afrique, l’Italie a tapé poteau en Ethiopie.
Certains analystes vous diront que la France est sortie comme l’une des principales gagnantes de la Conférence de Berlin de 1884 qui a consacré le partage colonial de l’Afrique, parce que Bismarck aurait voulu apaiser la colère de la France après sa défaite en 1870 face à l’Allemagne unifiée.
Après la Seconde guerre mondiale et l’ascension du Général de Gaulle à la magistrature suprême en 1958, la France va voir sa doctrine de politique étrangère complètement muée, comme un reptile en pleine croissance.
En effet, la politique étrangère du Général de Gaulle a été marquée par cette obsession de restaurer la grandeur de la France dans le monde. Pour de Gaulle, il n’est pas question pour la France de faire profil bas devant les deux superpuissances dominantes issues de la Seconde guerre mondiale.
« Une certaine idée de France » a amené de Gaulle à s’opposer systématiquement et souvent frontalement aux Etats-Unis et à l’URSS dans les forums internationaux ou sur les grandes questions diplomatiques du moment.
L’exemple illustratif de cette attitude a été le retrait des troupes françaises de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en pleine Guerre froide en 1962. Pis, de Gaulle a poussé le bouchon en se rapprochant l’URSS en effectuant le premier voyage officiel d’un haut dirigeant du bloc occidental en URSS en 1966.
On peut multiplier les exemples de la défiance française face aux deux grands du moment. Il faut ajouter que la Grande Bretagne, sa rivale éternelle, par contre, a choisi une option de rapprochement avec les Etats-Unis, son ancienne colonie devenue superpuissance. Cette relation sera qualifiée de « spécifique » par beaucoup d’analystes.
En Afrique noire, la politique étrangère du Général de Gaulle sera marquée par cette volonté de garder un contrôle de fer sur les anciennes colonies en plaçant à leurs têtes des élites à sa solde.
Du Niger au Gabon en passant par la Côte d’Ivoire et le Sénégal, la France organise sa décolonisation de façon à remettre le pouvoir à des élites favorables à sa présence en Afrique noire. Ainsi, elle est rassurée de son plein accès aux ressources pétrolières, agricoles et minéralières de l’Afrique noire, chose dont elle ne peut disposer ailleurs à un prix qui lui convient.
En contrepartie, la France s’engage à fournir à ses gouvernants africains « amis » de l’aide économique et de la protection.
En 1958 juste avant le référendum devant décider le sort de l’empire colonial français en Afrique noire, de Gaulle dit ceci : « Bien sûr, je comprends que l’indépendance fascine et pousse à la sécession. Le référendum (de 1958) nous dira si l’idée de sécession l’emportera ou non.
C’est qui est inconcevable cependant c’est un Etat (africain) indépendant que la France continue à aider » (Meredith, 2011 : 67). Sékou Touré de la Guinée Conakry ne tardera pas à comprendre le sens de ces mots du général français.
En somme, la doctrine de la politique africaine de la France, de Gaulle à nos jours, se résume en ceci : construire son indépendance en réduisant celle des pays africains à néant.
C’est vraiment tragique pour les grandes puissances que pour assurer leur indépendance et leur grandeur l’on soit obligée de réduire les autres pays en des entités satellites (Mearsheimer, 1991).
C’est la tragédie du prédateur qui se voit obligé d’ôter la vie de ses proies pour assurer la sienne. Outre cette dimension tragique, la politique africaine de la France se caractérise par une incroyable continuité de de Gaulle à Macron. Une telle continuité a poussé certains analystes à parler d’obsolescence de la politique africaine de la France.
Partie II : La doctrine de politique étrangère de la France envers l’Afrique noire est-elle devenue obsolète ?
Oui, le logiciel de la politique africaine de la France est devenu obsolète. Avant de décortiquer cette réponse, il importe de faire quelques rappels historiques. Sortie fortement affaiblie de la Seconde guerre mondiale, la France se trouve confrontée à la grogne anticoloniale en Asie, en Afrique.
Pis, elle ne parvient pas à rétablir sa présence coloniale en Indochine avec la défaite de Dien-Bien Phu en mai 1954. Comme un malheur n’arrive jamais seul, la guerre d’Algérie éclate à peu près au même moment.
En Afrique noire, « les porteurs de pancartes » à Dakar s’organisent contre la France, lui demandant de partir. Cette grogne anticoloniale va créer une grave crise socio-politique en France.
A la faveur d’un coup de force déguisé, de Gaulle revient au pouvoir en 1958 car ayant pu faire le consensus au sein de l’élite politique comme l’homme-messie pouvant résoudre la crise algérienne.
Arrivé au pouvoir, de Gaulle impose sa propre architecture politique. En matière coloniale, il décide de décoloniser pour mieux préserver l’influence française. En Afrique noire, il met en place le modèle Foccart (Battistella et al., 2012), du nom de son secrétaire général aux affaires africaines le célèbre Jacques Foccart, qui va organiser la liquidation des rebelles camerounais de l’Union des Peuples du Cameroun (UPC), la cooptation des leaders modérés comme Senghor, Houphouet-Boigny, Hamani Diori, l’isolement et l’étranglement des leaders comme Sékou Touré de la Guinée Conarky, Djibo Bakary du Niger , Thomas Sankara du Burkina Faso, etc.
De Gaulle en 1958 en passant par Macron en 2023, ce dispositif n’a pas changé. Aucun analyste des relations franco-africaines ne dira le contraire. Outre son caractère tragique, la politique africaine de la France se caractérise par son étonnante continuité.
Or les choses ont fortement changé en Afrique noire dans tous les aspects à tel point que l’Afrique noire des années 2023, Afrique des réseaux sociaux et d’une jeunesse nombreuse en quête d’espoir, raison pour laquelle un grand économiste africain parle d’urgence africaine (Nubukpo, 2019), ne ressemble en rien à l’Afrique des indépendances des années 1960.
Comme un logiciel, toute doctrine de politique étrangère a besoin de mises à jour en vue d’adapter les faits et gestes des hauts dirigeants politiques du pays en question aux réalités internationales du moment, surtout quand il s’agit de votre sphère d’influence comme c’est le cas de la France en Afrique noire.
A force d’avoir oublié de mettre à jour son logiciel de politique africaine, la France a rendu sa doctrine africaine carrément obsolète, laquelle obsolescence explique les déboires et la débâcle qu’elle est en train de vivre actuellement en Afrique sahélienne.
Dans ce morceau ci-dessus, nous avons tenté de démontrer que la France a bel et bien une doctrine de politique étrangère envers ses anciennes colonies. Cependant, celle-ci est devenue obsolète par manque de mises à jour nécessaires. Or les signaux d’avertissement n’ont pas manqué.
On peut citer, entre autres, l’avènement de la révolution sankariste dans les années 1980 au Burkina Faso, la vague de protestations contre les régimes autoritaires africains mis en place et soutenus par la France dans les années 1990, la crise ivoirienne dans les années 2000 avec ses Jeunes Patriotes, etc. D’une crise à une autre, la politique africaine de la France se caractérise par une véritable myopie. Le coq gaulois a vraiment déçu en Afrique sahélienne !
Dr. Jean-Baptiste GUIATIN
Fulbright 2016
Conseiller des affaires étrangères