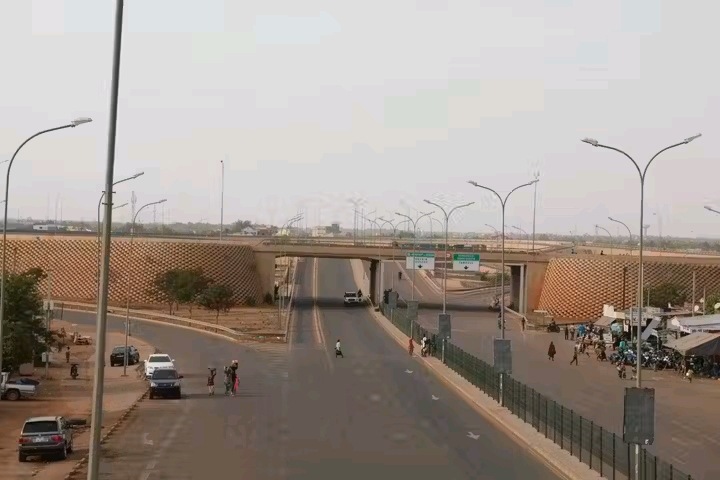La crise sécuritaire liée au terrorisme a contraint plusieurs personnes à fuir leurs localités d’origine. En majorité agriculteurs, les déplacés internes rencontrent d’énormes difficultés pour accéder aux terres dans leurs localités d’accueil. Si elles ne sont pas contraintes de louer les terres malgré leur précarité, elles sont obligées de vivre des dons parce qu’elles n’ont plus d’espace de production.
Par Daouda Kiekieta
« J’ai fait près de deux ans à chercher avant de trouver une terre pour cultiver. Quand j’étais chez moi, l’agriculture était ma principale activité ». Ce sont là les propos de Harouna Sawadogo, personne déplacée interne (PDI) vivant à Louda un village situé près de Kaya dans la région du Centre-Nord du Burkina.
En 2019, face à la progression des terroristes, il a fui son village Lilgomdé, dans la commune de Arbinda, région du Sahel. Les propos de M. Sawadogo illustrent bien la réalité que vivent bon nombre de PDI pendant la saison d’hivernage. Alors qu’elles étaient des grandes productrices agricoles dans leurs localités d’origines, les PDI se retrouvent dans une situation de vulnérabilité ne vivant plus que des aides alimentaires.

En cette matinée du 27 juillet 2022, nous quittons l’ambiance citadine de Kaya, marquée par le vrombissement des engins. Direction Louda, située à environ 5 km à l’ouest de la ville, pour y rencontrer la famille de M. Sawadogo qui exploite moins d’un demi-hectare de terre.
« Quand j’étais chez moi, j’emblavais au moins 6 hectares chaque année. Ce que je fais ici, c’est insignifiant. Mais on n’a pas le choix. Que la paix revienne pour que nous puissions regagner nos villages », nous raconte M. Sawadogo.
Des personnes déplacées internes louent des terrains pour cultiver
Après la rencontre avec notre premier interlocuteur, nous mettons le cap sur un site de personnes déplacées internes (PDI) situé dans le village de Lelescé, au nord de la ville. A la périphérie de ce site, nous rencontrons des PDI venues de Boulsbaogo, commune de Barsalogho. Ils y louent des champs pour cultiver.
A notre arrivée sur les lieux, point question de demander s’il s’agit des personnes vulnérables. On y voit des tentes leur servant de logement. Celui de Ali Sawadogo se trouve au pied d’une monticule où il habite avec ses deux femmes et ses sept enfants.
Lire aussi: Kaya : la vie « difficile » des veuves déplacées internes
Autour de la tente qui porte le logo et le sigle du Haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (UNHCR en anglais), sont disposés des cailloux sauvages pour minimiser les risques d’inondation.
La famille Sawadogo est venue de Barsalogho,45 kilomètres de Kaya, chef-lieu de la région du Centre nord. Pour cette saison d’hivernage, elle se déplace à près de 10 km à vélo ou à moto pour aller cultiver. Et là aussi, il a fallu moultes négociations pour que le propriétaire terrien accepte de donner son terrain.
« Je suis allé voir un autochtone pour solliciter un terrain pour cultiver. Il m’a dit qu’il pouvait me céder le terrain à condition que l’on partage à moitié-moitié les récoltes. J’ai une grande famille à nourrir et le terrain est petit pour produire une quantité importante de céréales à même de combler nos besoins alimentaires. Donc j’ai dû aller chercher ailleurs. Là où j’ai finalement eu un terrain, c’est à 10 km de notre maison. Je m’y rends parfois à moto ou à vélo. Mais mes femmes et mes enfants vont à pied », explique Ali Sawadogo.
Si Ali Sawadogo a pu avoir un terrain gratuitement, Karim Sawadogo, lui, n’a pas eu cette chance. Il est obligé de louer un lopin de terre. « Partout où on est allé demander un terrain pour cultiver, ils nous demandent de faire un geste (donner de l’argent, ndlr). Certains nous disent de donner 15 000 F.CFA d’autres exigent 25 000 F.CFA », soutient Karim, ajoutant que « si la superficie du champ était importante, ça va. Mais, avec cela, on est obligé de faire de petits travaux, comme être manœuvre, à côté. Et même pour trouver ces petits travaux, c’est compliqué ».
Les femmes déplacées internes sont les plus touchées
Au secteur 6 de la ville de Kaya, la question de l’accessibilité des terres par les PDI se pose avec acuité. Situé au Nord-Est de la ville, ce secteur accueille des milliers de PDI, essentiellement des femmes qui sont en première ligne en matière de résilience. Malgré leur situation de vulnérabilité, elles sont obligées de débourser de l’argent pour accéder aux terres, en plus des dépenses liées aux logements.
La cinquantaine bien sonnée, Pogzinga Pafadnam, déplacée venue de Dablo, nous confie : « J’ai payé 10 000 pour ce petit terrain. Et on ne nous laisse pas cultiver pour payer à la fin de la saison. On paye avant de commencer. Si tes récoltes sont bonnes tant mieux. Dans le cas contraire, eux, ils ont déjà pris leur argent ». Pogzinga Pafadnam n’est pas la seule dans cette situation.
Toumasgo Pafadnam, mère de sept enfants, vit le même calvaire. En plus de son loyer, elle a payé 7 500 F.CFA l’année passée. Elle a dû débourser la même somme cette année pour acquérir un lopin de terre de quelques mètres carrés seulement. « Les propriétaires sont stricts. On paie en début de saison», dit-elle. Le visage pâle, elle n’oublie pas le jour où elle était obligée par les terroristes de fuir Dablo avec ses enfants pour se réfugier à Barsalogho. De Barsalogho, l’exode a continué jusqu’à Kaya.

Autre lieu, même calvaire. A Ziniaré, chef-lieu de la région du Plateau central , c’est le même constant lorsque nous y avons mis pied. Salamata Bamogo, personne déplacée interne ne sait plus à saint se vouer. Deux ans maintenant que cette mère de 14 enfants a fui Djibo, dans la région du Sahel. Elle avoue avoir été bien accueillie par un tuteur. Par contre, les terres qu’elle et sa famille exploitent ont été louées. « Nous louons chaque année le champ de 4 hectares, à raison de 20 000 F.CFA l’hectare », explique-t-elle avant d’ajouter qu’elle a 14 enfants et certains sont allés à la recherche de l’or dans les collines.
Les raisons de l’inaccessibilité des terres
Simon Sawadogo est autochtone de Kaya. Âgé de 60 ans, il dit avoir accueilli plus de trente personnes déplacées chez lui. Selon ce vieil homme, certains autochtones n’ont même pas de terres cultivables, à fortiori à donner à un tiers. « J’ai accueilli successivement plus de trente (30) personnes déplacées. Actuellement, onze (11) sont toujours avec moi. Mais je n’ai pas pu leur donner de terres à cultiver, parce que je n’en dispose même pas », dit-il.
Son avis est partagé par Boukaré Bamogo, Coordonnateur général de l’Association action vision développement (AVAD) au Centre-Nord. La structure qu’il dirige travaille pour l’atteinte de la sécurité alimentaire dans la région du Centre-Nord.
Lire aussi: Éducation : 305 enfants déplacés internes en attente de scolarisation à Ouagadougou
Son coordonnateur soutient également que le problème d’accessibilité des terres par les PDI s’explique par le manque de terres cultivables par les tuteurs eux-mêmes. « Il faut saluer l’ouverture et la disponibilité de certaines populations hôtes. Mais avec les conditions de vie de plus en plus difficiles de ces derniers, ils ont été par la suite débordés » dit-il avant. Les tuteurs ont déjà consentis d’énormes efforts, mais se trouvent absorbés par les difficultés, poursuit Boukaré Bamogo.
Narcisse Syan est chef de service provincial du foncier, de la formation et de l’organisation du monde rural. Il explique, pour sa part, que la monétisation de la terre est l’une des raisons principales de son difficile : « Certains vendent des lopins de terre à ces personnes vulnérables ».

La spéculation foncière, selon M. Syan, limite l’accès des terres cultivables aux PDI. « Comme la terre a de la valeur marchande de nos jours, ceux qui en possèdent sont plus orientés vers les personnes capables de leur procurer vite de l’argent en un temps record. On sacrifie ainsi les couches vulnérables et même les générations à venir » déplore-t-il.
Des alternatives pour remédier au problème
Dans la région du Centre-Nord, des actions sont développées pour la récupération des terres dégradées au profit des PDI et de leurs tuteurs.
Pour les villages qui n’en ont pas par contre, la récupération des terres se font entre populations hôtes et personnes déplacées. « A la fin de cette récupération, les propriétaires acceptent de céder une partie de leurs terres aux PDI », explique Boukaré Bamogo.
Lire aussi: Burkina Faso : le besoin alimentaire des déplacés internes estimé à 95%
Chez les personnes déplacées internes qui ont pu avoir une portion de terre, certains ont déjà mis en place des techniques de fertilisation pour accroître les rendements. A Lelescé les pratiques du Zaï et des demi-lunes sont de plus en plus courantes. « Je ne connaissais pas le Zaï quand j’étais chez moi. Ici, nous sommes obligés de creuser pour le Zaï parce que, non seulement les terres que nous avons eu sont arides, mais aussi les superficies ne sont pas grandes », affirme Ali Sawadogo.
De son côté, M. Syan de la direction provinciale de l’agriculture du Sanmatenga, préconise la « poursuite de la sensibilisation auprès des hôtes, car, chacun peut se trouver dans une situation inconfortable demain ». Il estime aussi que les ONG et les projets doivent appuyer davantage les personnes déplacées dans l’acquisition des facteurs de production. « Même avec un lopin de terre, s’il n’y a pas de semences, d’engrais et de produits de traitement des plantes, cela sera un peu difficile pour eux (PDI ndlr) d’obtenir de bonnes productions », défend-t-il.
Selon le Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR), le Burkina Faso enregistre au total 1 902 150 PDI à la date du 30 avril 2022. La région du Centre-Nord accueille plus de PDI, avec 35% soit près de 700 mille personnes. Pour la campagne agricole 2021-2022, le pays a perdu 384 702 ha de superficies cultivables et 323 093 de tonnes de production à cause de l’insécurité, selon le premier Ministre Albert Ouédraogo lors la session ordinaire du Comité national de pilotage des pôles de croissance (CNPPC), tenue le 15 juillet 2022.